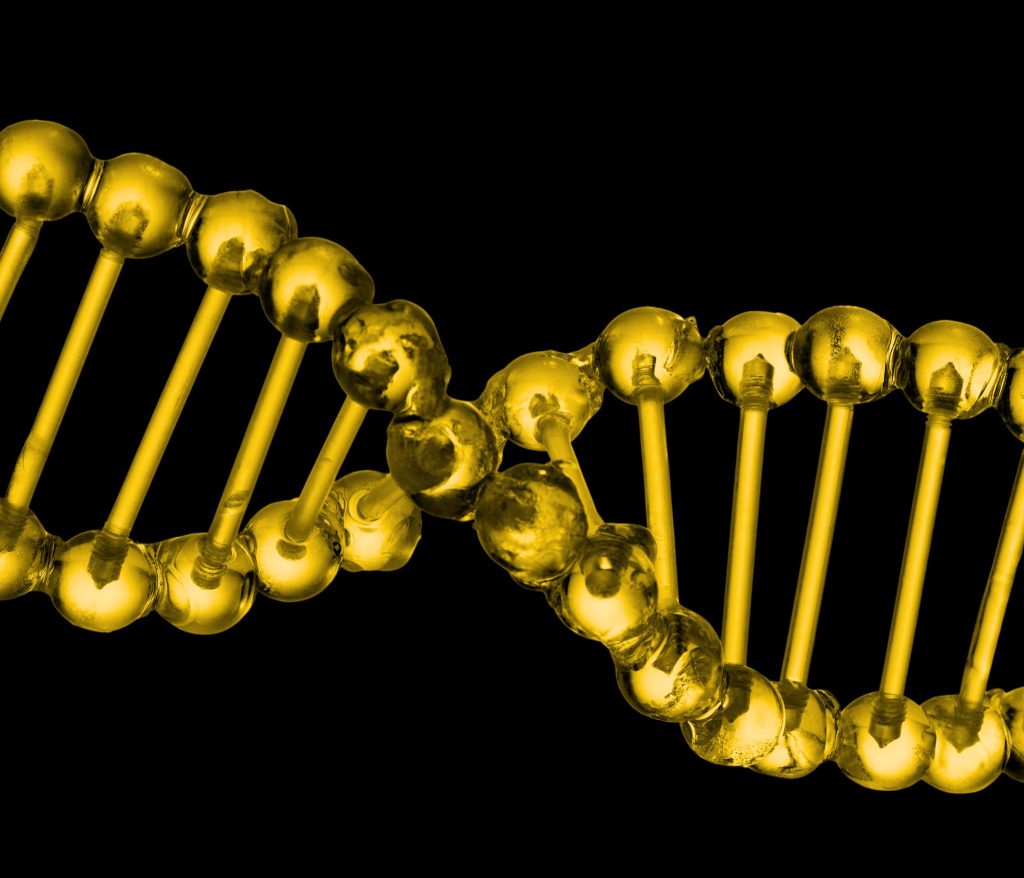La biologie de synthèse, une menace pour la biodiversité
En raison des activités humaines, la biodiversité s’effondre à une vitesse alarmante. Selon l’IPBES, un panel rassemblant 1 500 scientifiques à travers le monde, en 200 ans les extinctions d’espèces ont accéléré de 10 à 1 000 fois par rapport à leur rythme naturel. À travers le monde, différentes stratégies doivent être mises en place pour tenter d’enrayer cette extinction : lutte contre la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, contre la surexploitation des ressources et le trafic illégal d’espèces, contre la pollution – des milieux aquatiques, de l’air, des sols par des substances dangereuses – et le réchauffement climatique… Mais ces solutions globales, qui nécessitent un investissement de long terme et une remise en cause des modes de vies destructeurs, risquent d’être supplantées par des réponses court-termistes et techno-solutionnistes.
Les avancées scientifiques en matière de génétique conduisent aujourd’hui au développement d’une nouvelle discipline, la biologie de synthèse, qui vise à appliquer des principes d’ingénierie à la biologie, pour concevoir ou modifier des organismes en vue de leur conférer des fonctions spécifiques. Cette nouvelle discipline met à disposition un certain nombre d’outils qui pourraient être appliqués à la protection des écosystèmes, comme la modification génétique d’espèces pour les rendre résistantes aux maladies ou aux effets du réchauffement climatique, ou encore l’éradication d’espèces qualifiées d’invasives, voire même la « résurrection » d’espèces disparues.
La plupart de ces applications de la biologie de synthèse restent hypothétiques, aucune n’a encore prouvé son efficacité. En revanche, les risques associés à ces nouvelles techniques sont bien réels, et ils doivent être considérés avec la plus grande attention.
D’abord, des incertitudes scientifiques entourent encore la biologie de synthèse : notre compréhension de la complexité des interactions au sein des écosystèmes est trop lacunaire pour prétendre modifier sans risques les caractéristiques génétiques de certaines espèces. Une fois libérés dans la nature, les organismes génétiquement modifiés ne peuvent plus être contrôlés, avec un risque de conséquences en cascade sur les écosystèmes. Un des outils de la biologie de synthèse – appelé le forçage génétique – augmente, par exemple, grandement la probabilité de transmission des modifications génétiques d’un individu à sa descendance, ce qui pourrait conduire à modifier le génome d’une espèce de manière définitive. Impossibles à anticiper, les conséquences de la libération d’organismes issus de la biologie de synthèse dans la nature pourraient donc aussi être irréversibles.
Enfin, les modifications génétiques d’espèces entrent en contradiction avec les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Ces transformations irréversibles – réalisées sans la concertation des populations qui habitent ces écosystèmes et entretiennent avec eux des relations profondes, culturelles, parfois de l’ordre du sacré – remettent en cause la souveraineté de ces communautés sur leurs territoires, ainsi que leur rôle précieux dans la préservation de la biodiversité.
Loin de proposer une solution miracle pour sauver les espèces de la disparition, la biologie de synthèse risque en réalité de mettre gravement en danger des écosystèmes déjà fragilisés par l’Homme. Ces réponses techniques à l’effondrement de la biodiversité sont contreproductives. Elles modifient notre vision de la nature, qui devient un espace qui peut être contrôlé et perfectionné par la main humaine, et empêchent de s’attaquer aux origines réelles des crises écologiques que nous traversons : nos modes de vie et de production destructeurs.
Depuis plusieurs années, les négociations se multiplient au niveau mondial pour introduire les outils de la biologie de synthèse dans la protection de la nature. Principal théâtre de ces discussions, le congrès mondial de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a vu défiler des motions ouvrant la voie à l’utilisation de ces techniques.
Avec un collectif d’organisations, POLLINIS porte auprès des membres de l’UICN un moratoire, pour suspendre l’utilisation des techniques issues de la biologie de synthèse dans la protection de la nature. Ce moratoire pourrait être voté lors du prochain congrès mondial de l’UICN, organisé à Abu Dhabi du 9 au 15 octobre 2025. S’il était adopté, il permettrait d’empêcher la libération incontrôlée d’organismes génétiquement modifiés dans la nature, dans l’attente : de réponses scientifiques sur les risques de la biologie de synthèse ; de la mise en place de réglementations solides pour encadrer l’usage de ces techniques ; de garanties pour la préservation des droits des peuples autochtones ; et enfin de l’émergence d’un consensus dans la société sur l’usage de ces techniques qui modifient considérablement notre rapport à la protection de la nature.
L’examen de cette motion lors du congrès d’Abu Dhabi est le fruit d’un combat de longue haleine, mené depuis plusieurs années par POLLINIS et ses alliés au niveau mondial.
En 2021, lors du congrès mondial de Marseille, une motion a été adoptée, pour demander aux membres de l’UICN de travailler à l’élaboration d’une politique sur l’implication de la biologie de synthèse dans la conservation de la nature. Après d’âpres négociations, un groupe d’organisations – dont POLLINIS – a réussi à inclure dans cette motion la nécessité de l’application du principe de précaution, ainsi que la création d’un groupe de travail paritaire sur le sujet, permettant notamment de prendre en compte l’avis des populations autochtones dans l’élaboration de cette politique. Cette nouvelle politique de l’UICN doit être présentée en octobre 2025, lors du prochain congrès mondial à Abu Dhabi.
Mais, en 2024, les négociations ont pris un tournant inquiétant. Lors du congrès régional de l’UICN à Bruges – réunissant les membres de l’Union venus d’Europe et d’Asie centrale et du nord – les discussions autour de la biologie de synthèse ont été menées dans un cadre très favorable à l’utilisation de ces solutions pour la conservation de la nature. L’UICN a, par exemple, choisi de confier l’animation du groupe de travail chargé d’élaborer sa feuille de route politique au Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB), un fervent soutien de la biologie de synthèse. Le groupe de travail proposé par plusieurs organisations, dont POLLINIS, pour permettre une approche équilibrée du sujet risque donc d’être dévoyé.
L’adoption d’un moratoire permettrait d’empêcher le développement trop rapide et la dispersion incontrôlée d’organismes génétiquement modifiés dans la nature. Dans l’attente d’un examen scientifique approfondi des risques associés à ces technologies, de l’instauration d’un cadre réglementaire strict, et de l’ouverture d’une réflexion collective – incluant les peuples autochtones – sur notre vision de la protection de la nature.