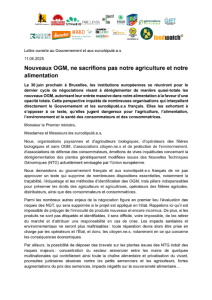Biotechnologies génétiques / Nouveaux OGM
« Scientifiquement injustifié », « irréaliste »… Une autorité scientifique allemande épingle le projet européen de dérégulation des nouveaux OGM
Des scientifiques du BfN, l’agence fédérale allemande pour la protection de la nature, ont publié une analyse du projet de règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques (NGT). Le texte, en cours de négociation à Bruxelles, vise à exempter la quasi-totalité de ces nouveaux organismes génétiquement modifiés des règles actuellement en vigueur pour encadrer les OGM en Europe. L’autorité allemande dénonce particulièrement les critères retenus pour créer la catégorie de plantes concernées par cette dérégulation.

Mi-septembre, trois scientifiques du BfN (Bundesamt für Naturschutz) – l’autorité scientifique allemande responsable de la protection de la nature -, ont publié un article pour livrer leur position sur le projet de règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques (NGT). Depuis plusieurs mois, ce texte est en cours de négociations entre les institutions européennes, pour aboutir à une version finale qui doit encore être votée.
Pour le moment, le projet de la Commission européenne prévoit notamment de créer une nouvelle catégorie de plantes obtenues en utilisant les nouvelles techniques génomiquesDes plantes modifiées sans introduction d’un gène extérieur, à l’aide de nouvelles techniques d’édition du génome développées ces dernières années. Parmi ces techniques, on retrouve principalement les “ciseaux moléculaires” CRISPR-Cas9, un outil qui permet – en théorie – de couper l’ADN à un endroit précis et pour y introduire un nouveau brin d’ADN., la catégorie NGT1. Toutes les espèces classées dans cette famille seraient alors considérées comme équivalentes aux plantes issues de la sélection conventionnelle, et donc exemptées des règles qui encadrent aujourd’hui l’utilisation des OGM dans l’Union européenne (évaluation des risques, obligation de traçabilité et d’étiquetage entre autres).
Un projet européen sans fondement scientifique
Pour les scientifiques du BfN, les critères retenus pour créer cette catégorie NGT1 supposément équivalente aux plantes conventionnelles sont « scientifiquement injustifiés et contreviennent au principe de précaution ». Pour appartenir à cette catégorie, la Commission européenne a décidé de fixer des seuils chiffrés. Une plante obtenue par NGT peut subir cinq types de modifications génétiques différents, parmi lesquels on retrouve la substitution ou l’ajout de 20 nucléotidesMolécules, représentées sous formes de lettres, qui composent l’élément de base de l’ADN. Une séquence ADN peut ainsi se résumer à une succession de nucléotides. maximum dans le génome. Au total, une plante obtenue par NGT peut subir 20 mutations génétiques, parmi ces 5 types de modifications. Ainsi, une espèce pourrait endurer la modification de jusqu’à 400 lettres de son code génétique (une substitution ou un ajout de 20 nucléotides maximum, répétée 20 fois). Ce nombre peut même être plus important si on considère un autre type de modification – la délétion, c’est à dire la suppression de nucléotides dans le génome – qui est autorisée pour un nombre infini de nucléotides.
Au-delà du nombre important de modifications génétiques qu’autoriserait la proposition européenne, les seuils chiffrés définis par la Commission sont jugés arbitraires et simplistes par les scientifiques du BfN, car ils « ignorent complètement le facteur le plus important : le contexte génétique ». En effet, en proposant un simple seuil chiffré, la Commission européenne met sur le même plan des modifications génétiques aux effets négligeables et des mutations apportées à un gène vital, comme si les conséquences de ces modifications étaient les mêmes.
De plus, dans le document technique appuyant son projet de règlement, la Commission justifie son choix de seuil chiffré en indiquant qu’une plante pourrait – en théorie – également subir 20 modifications génétiques de façon naturelle, ou via des techniques de sélection conventionnelle. Une justification sans fondement, dénoncent les scientifiques du BfN. Certes, des mutations génétiques aléatoires peuvent se produire naturellement, mais cela n’est en rien comparable avec les modifications génétiques ciblées permises par les nouvelles techniques génomiques. Dans la nature, la probabilité d’atteindre 20 mutations génétiques précises est comparable à celle de gagner au loto à 20 reprises, expliquent les scientifiques. Un scénario « irréaliste ».
Un projet qui ouvre la voie à des modifications génétiques complexes, sans évaluation des risques
En déterminant des seuils chiffrés, la Commission européenne donne ainsi une fausse impression d’encadrement et de sécurisation de l’usage des plantes issues des NGT. Or, le projet de règlement autorise, sans aucun contrôle, des modifications génétiques qui ne seraient jamais apparues de façon naturelle ou par des techniques de sélection conventionnelles. Avec des outils d’édition du génome tels que CRISPR-Cas9, les scientifiques peuvent en effet réaliser des modifications dans des zones auparavant inaccessibles, bien au-delà de ce que permettent les méthodes traditionnelles de sélection et de croisement.
Les scientifiques du BfN signalent aussi que le projet de règlement européen ne contient aucune norme concernant l’espacement des 20 modifications génétiques autorisées dans l’ADN des plantes. Concrètement, si ces 20 mutations peuvent être réalisées côte à côte dans le génome, alors les nouvelles techniques génomiques pourraient permettre de remodeler complètement les fonctions ou les quantités produites de certaines protéines contenues dans les plantes. De cette manière, le texte européen « ouvre une faille technique », alertent les scientifiques, « sans tenir compte de la disposition ou de la fonction des modifications génétiques, même mineures, la proposition autorise des altérations génomiques complexes sous le couvert de l’équivalence [avec des mutations qui pourraient se produire via la sélection conventionnelle] ».
Le développement de l’intelligence artificielle ajoute aussi une nouvelle dimension aux risques associés au règlement européen. « En matière d’IA, la comparaison entre les NGT et la sélection conventionnelle est particulièrement infondée », estiment les scientifiques. Ces nouveaux outils pourraient, en effet, permettre la découverte de combinaisons de modifications inédites, grâce à l’analyse d’immenses bases de données génomiques et le développement d’outils de prédiction basés sur l’IA.
Enfin, le règlement européen précise également que le fruit de tout croisement entre deux plantes de la catégorie NGT1, qui viendrait à multiplier le nombre de modifications génétiques, peut rester classé dans cette même catégorie. Autant d’arguments qui prouvent que de simples seuils numériques arbitraires ne permettent pas d’encadrer suffisamment les risques associés au développement de plantes issues des NGT. Alors que les négociations sur le projet de règlement européen se poursuivent, les experts du BfN tirent la sonnette d’alarme : « En supprimant l’évaluation des risques au cas par cas, la proposition crée un vide réglementaire qui permet à des modifications génétiques nouvelles et complexes d’échapper à tout contrôle. »
L’autorité scientifique allemande n’est pas la seule à alerter sur les incohérences du projet de la Commission européenne, d’autres agences nationales ont déjà émis des critiques similaires. En France, dans un avis publié en novembre 2023, l’Anses avait également remis en cause la pertinence scientifique des critères établis par le projet de règlement sur la catégorie NGT1. Des craintes confirmées dans un second avis, publié en mars 2024, où l’Anses insiste sur la nécessité d’évaluer au cas par cas les risques des plantes issues des NGT avant toute mise sur le marché.