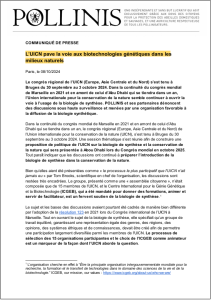Biotechnologies génétiques / Forçage génétique
La biologie de synthèse, une redéfinition dangereuse de la protection de la nature
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a organisé son congrès mondial du 9 au 15 octobre. Un évènement crucial, où s'est notamment négocié la place de la biologie de synthèse dans les stratégies de protection de la biodiversité. En amont du congrès, POLLINIS a mis en garde contre les risques de cette vision techno-solutionniste, qui redéfinit notre perception de la nature.

Selon l’IPBES, un panel qui rassemble près de 1 500 scientifiques du monde entier, depuis 200 ans les extinctions d’espèces sont 10 à 1 000 fois plus rapides que le rythme naturel. À cette vitesse, 75 % des espèces de la planète risquent de disparaître en 500 ans. En réponse à cette crise, des stratégies de conservation de la nature se développent pour préserver la biodiversité restante, en créant des zones protégées ou en luttant pour la survie de certaines espèces, par exemple. Mais aujourd’hui, de nouveaux outils issus de la biologie de synthèseLa biologie synthétique a pour objectif de concevoir en laboratoire des organismes qui n’existent pas dans la nature, ou de transformer des organismes existants en modifiant certaines de leurs caractéristiques. se proposent de remplir ce même objectif de préservation de la nature.
La plupart des applications concrètes de cette nouvelle méthode sont largement expérimentales, avec des effets qui restent à prouver. La modification génétique de certains arbres, par exemple, est brandie comme une solution pour améliorer leur résistance aux ravageurs et aux maladies. Dans le domaine de la défense des milieux marins, des scientifiques cherchent aussi à identifier des mutations génétiques permettant de rendre les coraux tolérants à la chaleur, pour améliorer leur résistance au réchauffement des océans. Des techniques de forçage génétiqueMéthode issue de la biologie de synthèse, qui vise à modifier de manière définitive le génome d’une espèce. Les organismes génétiquement modifiés transmettent ces modifications à leur descendance, ce qui permet à terme de propager de nouvelles caractéristiques à l’ensemble de l’espèce. sont aussi à l’étude, pour éliminer les espèces invasives.
Autant de projets opportunément présentés comme des solutions de haute technologie pour faire face à la crise écologique, à une époque où les méthodes traditionnelles de préservation de la biodiversité sont jugées trop lentes ou inadaptées. Toutefois, ces promesses s’accompagnent de graves inquiétudes. Les scientifiques impliqués dans le développement de ces technologies avertissent que la propagation d’organismes génétiquement modifiés dans la nature pourrait avoir des conséquences potentiellement irréversibles. Le forçage génétique, en particulier, est conçu pour propager rapidement des traits génétiquement modifiés à l’ensemble d’une population, ce qui amplifie aussi les conséquences de ces modifications, aussi bien intentionnelles qu’involontaires.
Deux visions de la nature
Derrière ce débat technique se cache un bouleversement plus profond. Appliquer les méthodes de la biologie de synthèse à la protection de l’environnement revient à en modifier les fondements, en redéfinissant non seulement notre capacité à intervenir, mais aussi les motivations et les modalités de ces interventions. Concrètement, la biologie de synthèse transforme l’objectif, les principes et même le discours de la préservation de la nature.
La protection de l’environnement vise à préserver la biodiversité, en respectant la complexité des écosystèmes et leur interconnexion. Elle reconnaît les limites des capacités humaines, en acceptant que nous ne comprenons pas pleinement les systèmes dont nous dépendons et que la prudence reste essentielle lorsque nous intervenons sur ces derniers.
D’un autre côté, la biologie de synthèse considère que la nature peut être améliorée. Elle repose sur l’idée que les écosystèmes peuvent être conçus, contrôlés et perfectionnés de manière rationalisée. Elle envisage les êtres vivants comme programmables, et leur environnement comme des systèmes qui peuvent être façonnés par des ingénieurs. Certes, elle offre des outils puissants, mais ils s’accompagnent d’une vision du monde qui prône l’intervention humaine et accorde une confiance aveugle aux nouvelles technologies.
Ces deux visions sont difficiles à concilier. La protection de la nature consiste à aider les écosystèmes à survivre et prospérer, tandis que la biologie de synthèse cherche à repenser et optimiser ces écosystèmes pour réparer les dommages causés par l’homme et, à terme, atteindre des ambitions humaines.
Le risque d’une normalisation des modifications génétiques irréversibles
Une grande partie du débat autour de la place de la biologie de synthèse dans la préservation de la nature se concentre sur les risques techniques associés à ces solutions : la question de savoir si les espèces génétiquement modifiées se comporteront comme prévu, si ces modifications génétiques peuvent affecter des organismes non-ciblés, ou bien si elles risquent d’avoir des conséquences environnementales imprévisibles. Ce sont des préoccupations légitimes, qui rendent nécessaire une évaluation rigoureuse des risques de la biologie de synthèse et l’application du principe de précaution.
Toutefois, normaliser des interventions génétiques irréversibles sur les espèces fait courir un risque plus profond. Celui de passer d’une philosophie de préservation de la nature qui valorise l’évolution génétique naturelle, à une approche qui considère les modifications génétiques permanentes réalisées par l’homme comme “naturelles”. Les voix des peuples autochtones – qui entretiennent une relation particulière avec la terre, les écosystèmes et leur conservation – seraient alors ignorées.
La biologie de synthèse pourrait aussi devenir un prétexte facile pour détourner notre attention de questions plus complexes et plus politiques. Le blanchiment des coraux, par exemple, s’explique par la hausse de la température des océans, elle-même causée par les émissions de gaz à effet de serre des industries fossiles. Modifier génétiquement les coraux pour qu’ils résistent à la chaleur peut apporter une solution temporaire, mais cela ne règle pas les causes profondes du réchauffement climatique.
Dans cette perspective, la biologie de synthèse risque de se substituer à des réponses plus globales, équitables et fondées sur l’écologie – et pourrait finir par renforcer les systèmes qui ont eux-mêmes causé le problème, sous couvert d’une promesse d’innovation.
Reformuler la question
Plutôt que de nous demander si la biologie de synthèse peut apporter des solutions pour préserver la nature, nous devrions nous poser une question plus profonde : De quel modèle de conservation de la nature voulons-nous ? Souhaitons-nous élaborer des stratégies de conservation fondées sur la protection des écosystèmes existants, ou sur leur modification ? Voulons-nous approfondir nos liens avec les écosystèmes, ou les remplacer par des solutions artificielles ?
Rappelons-nous que l’objectif n’est pas de surpasser la nature, mais de vivre en acceptant ses limites.
Cet article est une traduction française, cliquez ici pour retrouver la version originale écrite en anglais.