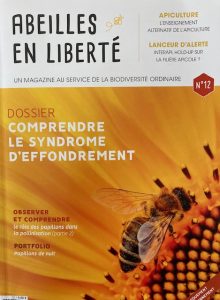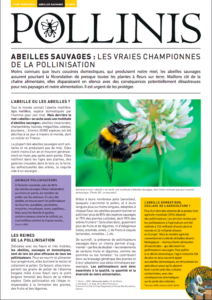Pollinisateurs
« Chaque espèce qui disparaît, c’est une partie du patrimoine qui s’efface » : En Europe, 10 % des abeilles sauvages menacées d’extinction
Denis Michez, professeur à l’université de Mons et spécialiste des abeilles sauvages, a coordonné la mise à jour de la liste rouge européenne des espèces menacées, publiée le 11 octobre. Son constat est alarmant : une centaine de nouvelles espèces sont en danger d’extinction.
Ce 11 octobre, à l’occasion de son congrès mondial, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a dévoilé une vaste mise à jour de sa liste rouge des espèces menacées. L’état de plusieurs groupes d’espèces a été réévalué, pour la première fois depuis les années 2010 : mammifères, amphibiens, reptiles, poissons, mais aussi abeilles et papillons.
Pour ces deux familles de pollinisateurs, la situation est inquiétante : 10 % des abeilles sauvages et 15 % des espèces de papillons sont menacées d’extinction en Europe. En 2022, l’UICN avait déjà évalué l’état des populations de syrphes – le troisième grand groupe de pollinisateurs – sur le continent, et a conclu que 37 % de ces espèces risquaient de disparaître.
Denis Michez, entomologiste et professeur à l’université de Mons, est le premier auteur et coordinateur de la mise à jour de la liste rouge des abeilles européennes menacées. Dans un entretien accordé à POLLINIS, il détaille les principales conclusions de cette étude, qui énumère non seulement les espèces en danger, mais pointe aussi les causes de ce déclin et formule plusieurs recommandations pour l’enrayer.

Grâce à cette actualisation de la liste rouge, nous disposons de l’évaluation la plus complète à ce jour de l’état des populations d’abeilles sauvages en Europe. Dans la version 2014 de cette liste, 57 % des espèces ne pouvaient pas être évaluées en raison d’un manque de données, ce chiffre est aujourd’hui passé à 14 %.
Comment fait-on concrètement pour collecter toutes ces données sur le terrain et affiner notre vision des populations d’abeilles sauvages en Europe ?
Derrière la publication des listes rouges, il y a un important travail de collecte de données, que nous croisons ensuite avec les critères établis par l’UICN La liste rouge comprend 9 catégories : Espèce éteinte, éteinte à l’état sauvage, en danger critique d’extinction, en danger, vulnérable, quasi menacée, préoccupation mineure, données insuffisantes et non évaluée.
On considère comme « menacées d’extinction » les espèces classées comme vulnérables, en danger et en danger critique. pour définir si une espèce est en risque d’extinction ou pas. D’abord, nous avons rassemblé les données de recensement d’abeilles qui existent à l’échelle européenne. À ce niveau, il y a une grande différence entre les données qui étaient disponibles en 2014 et celles qui le sont aujourd’hui. Des initiatives lancées par la Commission européenne ont alimenté le financement de plusieurs projets de recherche. Beaucoup d’éléments de la liste rouge de 2025 viennent, par exemple, du projet européen Safeguard.
À cela s’ajoutent les chiffres des pays qui ont lancé leurs propres inventaires des abeilles sauvages, comme la Suisse ou le Royaume-Uni. Il y a aussi des associations qui se sont créées comme l’Observatoire des abeilles en France, ou des ONG comme POLLINIS, qui stimulent l’intérêt du grand public et permettent la mise en place d’une science participative. Enfin, plusieurs musées ont numérisé leurs données, ce qui nous a permis d’avoir accès aux informations sur les spécimens qu’ils conservent. C’est le cas de musées clés comme celui de Linz en Autriche, ou Naturalis aux Pays-Bas.
Pour quelques pays avec une faible quantité de données disponibles, nous avons aussi organisé des campagnes sur le terrain, pour observer la présence d’espèces qui évoluent dans des espaces plutôt restreints. Ça a été le cas en Grèce et à Chypre. Évidemment, ce n’est pas possible de le faire partout en Europe et pour l’ensemble des espèces, donc le plus gros de notre travail a consisté à agréger un grand nombre de données existantes.
Quelles conclusions tirez-vous de cette collecte de données ? Aujourd’hui, quel est l’état des populations d’abeilles sauvages en Europe ?
Il y a évidemment de mauvaises nouvelles. Une centaine de nouvelles espèces d’abeilles entrent dans la liste rouge. Sur les 1 928 espèces évaluées, 10 % sont en danger d’extinction. Bien sûr, c’est en partie lié au fait qu’on a étudié davantage d’espèces qu’en 2014.
« Une centaine de nouvelles espèces d’abeilles
entrent dans la liste rouge.
Sur les 1 928 espèces évaluées, 10 % sont en danger d’extinction. »
Il y a des groupes qui sont particulièrement touchés, notamment les bourdons, dont 10 espèces figurent sur la liste rouge [parmi les près de 70 espèces de bourdons qu’on retrouve en Europe]. Cette plus grande vulnérabilité s’explique notamment par le fait que c’est un groupe d’abeilles qui est plus sensible au réchauffement climatique.
En revanche, la bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas encore d’espèces déclarées comme éteintes à l’échelle du continent. Ça veut dire qu’il est encore temps d’agir, nous n’avons pas atteint un point de non retour.

Le bourdon des friches (Bombus ruderatus) fait partie des espèces de bourdons classées comme menacées dans la liste rouge de l’UICN. Sur les près de 70 espèces de bourdons que compte l’Europe, 10 sont en danger d’extinction.
Image : Gustavo Pena Tejera
Vous l’avez dit, il y a des groupes d’espèces qui sont plus touchés que d’autres. C’est le cas des bourdons, mais aussi des collètes [également appelées abeilles cellophane] dont 14 espèces figurent sur la liste rouge. En quoi l’état de ces deux groupes est particulièrement inquiétant ?
On peut aborder le sujet de la conservation des espèces de plusieurs façons. D’abord, d’un point de vue éthique, on peut considérer que la disparition d’une espèce – peu importe sa place et l’importance de sa population – est dramatique. Parce qu’avec chaque espèce qui disparaît, c’est une partie du patrimoine dont nous avons hérité qui s’efface. Les prochaines générations ne pourront jamais s’émerveiller de la beauté de ces espèces.
On peut aussi envisager cette question de façon plus pragmatique et économique. Les insectes participent aux services de pollinisation et donc à la reproduction sexuée des plantes à fleurs. C’est un phénomène central dans le fonctionnement des écosystèmes mondiaux, et particulièrement en Europe. Parmi les plantes à fleurs pollinisées, on retrouve un grand nombre de cultures agricolesSelon l’IPBES, 75 % de nos cultures alimentaires et près de 90 % des plantes sauvages à fleurs dépendent, au moins en partie, de la pollinisation par les animaux., pour lesquelles une diminution de la reproduction entraînerait une baisse de la qualité et de la quantité de notre alimentation.
Certains groupes participent plus que d’autres à ces services écosystémiques. C’est évident que les espèces d’abeilles les plus rares, moins abondantes et limitées à de petites zones géographiques, vont moins y contribuer. À ce niveau, les bourdons font partie des pollinisateurs les plus importants, parce que ce sont des espèces sociales, qui vivent dans de grandes colonies et dans les écosystèmes tempérés partout en Europe. Si les populations de bourdons venaient à disparaître, leur abondance ne pourrait pas être remplacée.
De leur côté, les collètes évoluent dans une zone géographique restreinte, dans la péninsule ibérique. Ils participent localement aux services écosystémiques, mais leur disparition causerait davantage un dommage patrimonial qu’une perte économique. De mon point de vue, c’est tout aussi important !

Parmi les abeilles sauvages menacées, on retrouve notamment 14 espèces de collètes. Ces abeilles solitaires sont essentiellement présentes dans la péninsule ibérique. Ici, un collète fouisseur (Colletes fodiens), connu pour creuser son nid dans le sable.
Image : El Gritche
Au-delà d’évaluer les populations d’abeilles européennes, la liste rouge est aussi l’occasion de caractériser les menaces qui pèsent sur ces espèces. Pouvez-vous détailler un peu les principaux facteurs responsables de leur déclin ?
À l’image de l’ensemble de la biodiversité, le facteur majeur du déclin des abeilles c’est la destruction de leurs habitats. Les experts de la liste rouge pointent particulièrement la responsabilité de l’agriculture intensive, la coupe des haies, la monoculture…
Les abeilles évoluent dans de grands espaces ouverts, ce qui les rend d’autant plus vulnérables à l’utilisation de pesticides, mais aussi d’engrais et particulièrement des engrais azotés. Typiquement, en Belgique, dans les champs où le taux d’azote dans le sol augmente, cela favorise l’apparition des orties, qui ne sont pas utilisées par les abeilles comme des ressources en pollen ou en nectar. Dans des zones plus localisées, l’habitat des abeilles est aussi menacé par la bétonisation. Sur les côtes et les petites îles de la Méditerranée, par exemple, où l’immobilier se développe beaucoup en bord de mer.
De son côté, le réchauffement climatique a un impact plus mitigé sur les populations d’abeilles. Il peut entraîner la destruction d’habitats – on le voit avec les incendies, notamment dans le sud de l’Europe -, mais il peut aussi permettre d’étendre la distribution géographique de certaines espèces. En Belgique, par exemple, avec le réchauffement des températures on voit apparaître de nouvelles abeilles qui viennent probablement s’installer en raison de conditions climatiques un peu plus favorables.
La liste rouge prend en particulier l’exemple de l’abeille Dufourea (Dufourea minuta), auparavant répandue en Europe, qui a presque disparu des plaines d’Europe centrale et est maintenant classée comme menacée. L’usage des pesticides et des engrais est pointé comme responsable. Pouvez-vous revenir sur cet exemple ?
L’abeille Dufourea est particulièrement spécialisée, elle récolte du pollen sur un nombre limité de plantes de la famille du tournesol, les astéracées (Asteraceae). Elle est donc très sensible aux pesticides, notamment aux herbicides, qui sont typiquement utilisés pour empêcher le développement de ces plantes en bordure des champs. C’est une espèce qui supporte très mal les changements de qualité de son habitat, liés à l’intensification de l’agriculture et à la disparition des fleurs qu’elle butine.
Même si dans le cadre de la liste rouge nous n’avons pas relevé la littérature scientifique associée aux pesticides, de manière générale on peut évidemment dire que leur usage a un impact sur les insectes et en particulier les abeilles. Beaucoup de ces produits sont solubles dans l’eau et vont donc se diffuser partout dans les écosystèmes, être absorbés par des plantes qui ne sont pas à proximité des champs et impacter une variété de pollinisateurs.
Pour l’instant, les tests préalables à la mise sur le marché des pesticides sont essentiellement réalisés sur l’abeille mellifère, avec un ajout ponctuel des bourdons et des osmies. Mais cela représente seulement trois espèces sur les 2 138 recensées en Europe, ce qui pose problème parce qu’un grand nombre d’espèces sauvages sont plus sensibles aux pesticides que les abeilles mellifères. Une fois mis sur le marché, un produit qui satisfait des critères de moindre toxicité pour les abeilles domestiques peut représenter un danger pour un large nombre d’autres espèces.

L’abeille Dufourea (Dufourea minuta) est une espèce spécialiste : elle butine un petit nombre de fleurs, appartenant à la famille du tournesol. Une caractéristique qui la rend d’autant plus vulnérable aux herbicides, utilisés pour éradiquer ces plantes aux abords des champs. Aujourd’hui, elle a presque disparu des plaines d’Europe centrale.
Image : Bernhard Jacobi
À la lumière des conclusions de la liste rouge, quelles sont vos recommandations pour préserver les populations d’abeilles et enrayer les menaces qui pèsent sur ces espèces ?
Les solutions sont largement connues et éprouvées. Il faut diminuer les sources de stress qui affectent les abeilles, et donc notamment réduire notre usage des pesticides. Au niveau du consommateur, on peut, par exemple, adapter son panier au supermarché pour soutenir l’agriculture biologique, locale et de saison. Bien sûr, les actions doivent aussi venir des pouvoirs publics, au niveau législatif. On pense notamment à la politique agricole commune, qui peine à se verdir, mais aussi à des initiatives nationales. Récemment, en France, ce débat autour de notre modèle agricole est revenu sur la table avec la loi Duplomb. Heureusement, le retour des néonicotinoïdes a été empêché.
Pour les autres sources de stress, comme le changement climatique, c’est évidemment un peu plus compliqué parce que ce sont des combats de long terme. Mais, dans plein de domaines, le combat contre le réchauffement a des bénéfices pour la biodiversité et en particulier les pollinisateurs. C’est le cas du verdissement des villes, qui s’adaptent au réchauffement en limitant la construction de nouvelles infrastructures, en plantant des arbres… On peut tout à fait mettre ce type de politiques en place en y intégrant une dimension d’intérêt pour les abeilles. En plantant des arbres qui vont soutenir la biodiversité locale, en choisissant de planter des tilleuls européens plutôt que des platanes par exemple. À l’échelle individuelle, on peut aussi facilement améliorer la qualité de l’habitat des pollinisateurs locaux en plantant des fleurs dans son jardin ou sur son balcon.
Ces fleurs, ces arbres, ils vont très vite accueillir des abeilles. C’est aussi ça le message positif à porter : quand on lui laisse de l’espace, la biodiversité reprend très rapidement ses droits. Les abeilles sont des insectes très mobiles, qui colonisent les environnements propices en seulement quelques années.
« Quand on lui laisse de l’espace, la biodiversité reprend très rapidement ses droits. Les abeilles sont des insectes très mobiles, qui colonisent les environnements propices en seulement quelques années. »
Dans le champ des solutions pour protéger les espèces, un débat émerge autour de la biologie de synthèseLa biologie de synthèse vise à appliquer des principes d’ingénierie à la biologie, pour concevoir ou modifier génétiquement des organismes et leur conférer des caractéristiques spécifiques (modification génétique d’espèces pour les rendre résistantes aux maladies ou aux effets du réchauffement climatique, éradication d’espèces qualifiées d’invasives, « résurrection » d’espèces disparues…).. Il y a quelques jours, lors du congrès mondial de l’UICN, une motion défendue par POLLINIS pour instaurer un moratoire sur l’utilisation de ces techniques a été rejetée de peu, ce qui ouvre la voie à leur développement au service de la conservation de la biodiversité.
Quel est votre point de vue sur ces nouveaux outils ? Vous inspirent-ils plutôt de l’enthousiasme, ou de l’inquiétude ?
Je pense que la nature a déjà toutes les solutions en elle pour reprendre sa place, et que nous n’avons pas besoin de développer de nouvelles technologies pour sauver les espèces. Dans quelques cas mineurs, ces outils pourraient peut-être nous aider. Mais, de manière générale, à partir du moment où on redonne de l’espace à la biodiversité, elle reprend naturellement sa place. Ce qui va nous aider à la sauver, c’est de travailler sur la qualité des habitats. Tout ce qui ne va pas dans ce sens, c’est une perte de temps, une perte d’énergie, une perte de moyens.
« La solution par la technologie, on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas : le technosolutionnisme est un mirage politique. »
Ces nouvelles techniques posent aussi des questions plus philosophiques. La solution par la technologie, on a déjà essayé et ça ne fonctionne pas : le technosolutionnisme est un mirage politique. Chaque fois qu’une nouvelle technologie est développée, elle fait apparaître un certain nombre de solutions, mais elle génère aussi d’autres problèmes. Je suis un fervent défenseur des solutions par la nature, les solutions basées sur la technologie nous enferment dans d’autres problèmes.