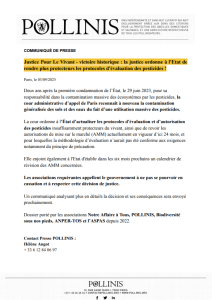Pesticides / Justice pour le vivant
Justice pour le Vivant : Ce que la décision de la cour administrative d’appel va changer
Ce 3 septembre, les associations de Justice pour le Vivant ont remporté une victoire majeure devant la cour administrative d’appel. La justice reconnaît la défaillance des protocoles de mise sur le marché des pesticides et demande, pour la première fois, la réévaluation des autorisations de ces substances. Une décision sans précédent, qui pourrait tout changer.

Il y a deux ans, le 29 juin 2023, le tribunal administratif reconnaissait la responsabilité de l’Etat dans la contamination massive des écosystèmes par les pesticides, dans le cadre d’un procès inédit intenté par les associations de la coalition Justice pour le Vivant (POLLINIS, Notre Affaire à Tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et l’ASPAS).
Ce 3 septembre, en appel, la justice est allée encore plus loin : elle exige que l’Etat corrige la défaillance des protocoles d’évaluation des risques des pesticides, qui ne respectent pas le principe de précaution en ne prenant pas en compte les dernières connaissances scientifiques, et demande le réexamen des autorisations de mise sur le marché délivrées en suivant ce protocole défaillant. POLLINIS détaille en trois points ce que cette décision de justice historique pourrait changer.

Le 6 juin, les associations de la coalition Justice pour le Vivant étaient réunies pour une audience face à l’Etat et au lobby des pesticides Phyteis, devant la cour administrative d’appel.
L’évaluation des risques des pesticides doit s’appuyer sur les dernières connaissances scientifiques
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour rappeler une règle primordiale, censée être au cœur du protocole de mise sur le marché des pesticides : les données scientifiques les plus récentes doivent être prises en compte dans l’évaluation des risques de ces substances.
Établi au niveau européen par un règlement de 2009, le système d’autorisation des pesticides fonctionne sur deux niveaux. À l’échelle de l’Union européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) émet un avis sur les risques d’une exposition à la substance active qui compose le produit, en se basant sur les informations fournies par le fabricant. En tenant compte de cet avis, la Commission européenne délivre ou non son autorisation de mise sur le marché. Les pesticides commerciaux sont ensuite évalués par les agences sanitaires des Etats membres, pour pouvoir être vendus sur le territoire. En France, c’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui est chargée de ce second niveau d’évaluation des produits.
Ce système, présenté comme l’un des plus protecteurs au monde, cache en réalité de nombreuses failles, dénoncées de longue date par POLLINIS. Il est d’abord miné par l’agro-chimie. Selon une vaste enquête publiée en 2018 par le réseau d’ONG PAN Europe, 92 % des méthodes européennes servant à l’évaluation des pesticides sont en partie conçues ou soutenues par l’industrie. L’évaluation de l’agence européenne et de ses homologues nationaux écarte donc largement les études scientifiques indépendantes les plus récentes. Un constat que la cour administrative d’appel reprend dans son arrêt : « L’ANSES ne fonde pas systématiquement son évaluation des risques sur les données scientifiques disponibles les plus récentes. »
Or, pour la cour, cette absence de prise en compte est contraire au règlement européen de 2009 sur l’évaluation des pesticides. Pour l’affirmer, les juges s’appuient sur deux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne. Une première, datée de 2019, qui affirme que le principe de précaution impose aux autorités des États membres de procéder à « une évaluation globale fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que les résultats les plus récents de la recherche internationale ». Puis une seconde, datée de 2024, qui précise que les agences sanitaires nationales ne peuvent se limiter aux documents d’orientation fournis par la Commission européenne pour rendre leur avis sur une substance, si « ces documents ne reflètent pas suffisamment l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques ».
« L’ANSES ne peut être regardée comme assurant une mise en œuvre satisfaisante du règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice, dans le respect du principe de précaution », fait ainsi savoir la cour administrative d’appel. Une décision révolutionnaire, qui impose à l’Etat de revoir ses protocoles d’évaluation des risques pour les rendre davantage protecteurs, notamment des espèces non-ciblées par les pesticides.
Les pesticides autorisés selon un protocole défaillant doivent être réévalués
En reconnaissant la défaillance des protocoles d’évaluation des risques des pesticides en France, la cour administrative d’appel admet aussi que la dangerosité d’un certain nombre de produits actuellement sur le marché n’a pas été correctement évaluée. « Les carences de l’Etat (…) ont conduit à des autorisations, même temporaires, délivrées à tort ou sans être assorties des prescriptions ou restrictions d’utilisation de ces produits qui auraient été nécessaires », constate le tribunal.
Pour y remédier, la cour impose ainsi à l’État de réexaminer les autorisations de mise sur le marché déjà délivrées et pour lesquelles la méthode d’évaluation utilisée n’est pas conforme aux exigences du règlement européen. Une décision inédite, que les autorités ont deux ans pour mettre en œuvre, après la présentation d’un calendrier prévisionnel de réexamen des autorisations concernées dans les six mois à venir. L’arrêt historique de la cour administrative d’appel pourrait donc conduire au retrait du marché de plusieurs pesticides toxiques, autorisés sans prise en compte des études scientifiques récentes qui prouvent pourtant leur toxicité.
Cela pourrait, par exemple, être le cas de l’herbicide le plus vendu au monde : le glyphosate, autorisé en Europe jusqu’en 2033. Des méta-analysesBattisti L, Potrich M, Sampaio AR, et al. (2021)pointent en effet sa toxicité pour les abeilles, pouvant accroître leur mortalité même lorsqu’il est épandu dans la limite des doses recommandées par le fabricant. Plusieurs étudesBalbuena, María Sol et al. (2015)Herbert, Lucila T et al. (2014)Farina, Walter M et al. (2019)Weidenmüller, Anja et al. (2022) montrent également que le glyphosate altère l’apprentissage, la mémoire, la navigation et les capacités de butinage des abeilles mellifères et des bourdons. Le prosulfocarbe, l’herbicide le plus utilisé en France, pourrait également être retiré du marché. Extrêmement volatile, le pesticide peut parcourir plusieurs kilomètres et contaminer des cultures biologiques, mais aussi les milieux aquatiquesSlaby, Sylvain et al. (2022)Bo, Xiaofei et al. (2020).
Les fongicides de la famille des SDHI, utilisés dans de nombreuses cultures pour tuer les champignons et moisissures, pourraient aussi disparaître des champs français. Depuis de longues années, POLLINIS se bat, jusque devant la Cour de justice de l’UE, pour que ces substances ne bénéficient pas de prolongation de leur autorisation de mise sur le marché sans nouvelle évaluation. C’est, par exemple, le cas du boscalid, réautorisé par la Commission européenne jusqu’en 2026, malgré sa toxicité pour les abeilles domestiques et sauvagesKopit, Klinger et al. (2022)Fisher II, Cogley et al. (2021), et son impact sur la mortalité des ouvrières et la diminution de la taille des colonies, même à faibles dosesFisher II, DeGrandi-Hoffman et al. (2021).
Les pesticides contaminent nos écosystèmes, sont responsables du déclin de la biodiversité et portent atteinte à la santé humaine
Comme il y a deux ans devant le tribunal administratif, la cour d’appel a reconnu la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les produits phytopharmaceutiques ». La justice pointe aussi une nouvelle fois la responsabilité de l’usage de pesticides dangereux dans le déclin de la biodiversité et de la biomasse.
Ce volet de la décision a un fort poids symbolique. Il bat en brèche les arguments martelés par le gouvernement et l’agrochimie durant le procès. En première instance comme en appel, le ministère de l’Agriculture a choisi de ne pas s’exprimer, laissant sa défense à Phyteis, le lobby des producteurs de pesticides en France, qui a demandé à intervenir pour protéger ses intérêts. Au tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, l’avocat de Phyteis a ainsi tenté de semer le doute dans l’esprit des juges, en avançant que le déclin de la biodiversité était également lié aux pollutions industrielles ou encore au changement climatique, pour diluer la responsabilité des pesticides dans cet effondrement.
Face à cette stratégie, la cour administrative d’appel est restée ferme : « Si le ministre de l’agriculture et le syndicat Phyteis font valoir que la contamination des eaux et des sols, le déclin de la biodiversité et la détérioration des chaînes trophiques ont d’autres causes que le seul usage des produits phytopharmaceutiques, telles que la pollution domestique et industrielle, la destruction des habitats naturels, la présence d’espèces envahissantes ou les évolutions liées au changement climatique, il n’en résulte pas moins de ce qui a été dit ci-dessus que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est responsable d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
Il y a deux ans, après la décision du tribunal administratif, le gouvernement avait choisi de répondre à sa condamnation par l’inaction. Aujourd’hui, il est au pied du mur : la justice lui impose de revoir les protocoles d’évaluation des pesticides et de revenir sur la commercialisation des produits injustement autorisés. L’Etat ne peut ignorer plus longtemps sa responsabilité en matière de protection de la biodiversité et de la santé humaine. La science et le droit l’obligent.