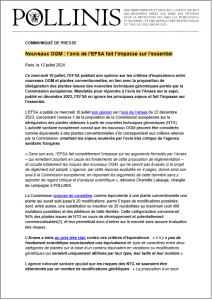Biotechnologies génétiques / Nouveaux OGM
Nouveaux OGM : POLLINIS répond aux 6 mirages de l’agrochimie et de la Commission
Alors que le sort des plantes issues des nouvelles techniques génomiques se retrouve entre les mains du Conseil de l'Union européenne, POLLINIS revient sur six des principaux mirages qui ont permis au projet de dérégulation des nouveaux OGM en Europe de voir le jour et d'être validé, à deux reprises, par le Parlement européen.
Les nouvelles techniques génomiques (NTG) ont plusieurs domaines d’application, notamment agricole. Et l’Union européenne, qui a pourtant longtemps préservé son agriculture des organismes génétiquement modifiés (OGM), pourrait bientôt céder aux sirènes de leurs fabricants.
La Commission européenne présentait en effet, le 5 juillet 2023, un projet de dérégulation visant à exonérer les plantes issues des NTG de toute obligation d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage. Et sept mois plus tard, le Parlement européen se prononçait en faveur de l’arrivée des nouveaux OGM sur le marché commun. Les discussions se poursuivent à présent au sein du Conseil de l’Union européenne, où les représentants des États membres ne trouvent pas encore de terrain d’entente.
L’avancement de ce projet est le fruit d’un argumentaire bien rodé que l’agrochimie déploie depuis plusieurs années, visant à faire passer leurs nouveaux produits comme des solutions écologiques et durables, et celles et ceux qui s’y opposent comme des adversaires à la science. Pour y voir plus clair, POLLINIS répond aujourd’hui aux six mirages déployés par l’industrie sur les nouveaux OGM :1 ) OUI, LES PLANTES ISSUES DES NTG SONT BIEN DES OGM
2) NON, LES PLANTES NTG NE SONT PAS SANS RISQUES
3) Certaines plantes NTG sont irréalisables en sélection conventionnelles
4) Oui, les critères d’équivalence de la Commission sont infondés
5) Non, les plantes NTG ne résoudront pas la crise climatique
6) Non, les plantes NTG ne réduiront pas l’usage de pesticides
Un lexique en fin d’article rassemble également les définitions de plusieurs méthodes employées pour modifier des végétaux.
1. Les plantes issues des NTG sont bien des OGM
Les nouvelles techniques génomiques (NTG) sont « des techniques de reproduction moléculaire utilisées pour modifier le matériel génétique d’un organisme » apparues après 2001, année d’adoption de la directive européenne relative aux OGM, selon l’Agence sanitaire européenne (EFSA). Jusqu’alors, les organismes génétiquement modifiés (OGM) dépendaient principalement de la transgénèse, à savoir l’insertion d’une séquence d’ADN issue d’une autre espèce. Ces possibilités limitées ont nourri une confusion entre OGM et OGM transgéniques, dont l’industrie agrochimique tire parti.
Si les NTGLa technique la plus utilisée à cet égard est CRISPR-Cas (voir lexique pour plus d’informations). permettent de modifier des organismes par transgénèse, elles regroupent aussi d’autres types de mutations du génome comme la cisgénèse (insertion d’une séquence d’ADN provenant de la même espèce) ou la mutagénèse ciblée (production de mutations à un endroit ciblé du génome).
Pour l’industrie, les NTG permettent de produire des plantes similaires à celles issues de la sélection conventionnelle, ce qui légitimerait de les sortir du cadre réglementaires applicable aux OGM. Pourtant, un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juillet 2018 classifie définitivement les organismes issus des NTG comme des OGM, conservant les végétaux NTG sous le coup de la directive de 2001.
2. Les risques des plantes NTG
En mars 2024, et après plusieurs semaines de blocage gouvernemental, la publication d’un rapport de l’Agence sanitaire française confirme l’existence de risques liés aux nouveaux OGM, et recommande « une évaluation au cas par cas des risques sanitaires et environnementaux » des plantes issues des NTG – et plus particulièrement de la mutagénèse dirigée obtenue grâce au système CRISPR-Cas. Les experts de l’Anses mettent entre autres l’accent sur :
- Des risques de modification des interactions avec les animaux en contact avec les plantes issues des NTG, notamment pour les pollinisateurs qui visiteront leurs fleurs ;
- Des risques de flux de gènes modifiés vers des populations sauvages, pouvant par exemple se répercuter sur des espèces envahissantes ;
- Et des potentiels effets cumulés sur l’environnement à long terme liés à la culture de différentes variétés issues des NTG et à l’augmentation des surfaces de ces culturesPour plus d'informations et d'exemples, consulter le tableau page 14 du rapport de l'Anses..
À cela s’ajoute le risque que, comme l’explique le Ministère de la Transition écologique pour la première génération d’OGM, « la très faible diversité de traits obtenus par les techniques d’ingénierie génétique et la nature de ces traits encourage le développement de systèmes agricoles non durables (monocultures, rotations courtes) avec des impacts sur la biodiversité et la résilience des écosystèmes ».
3. Des plantes NTG impossibles à obtenir en sélection conventionnelle
Les NTG offrent une immense liberté dans la mutation du génome : elles permettent non seulement de reproduire des mutations déjà existantes, mais également d’obtenir des mutations impossibles en sélection conventionnelle.
Par exemple, une tomate NTG commercialisée depuis 2021 au JaponCette tomate synthétise davantage de GABA, c’est-à-dire d’acide gamma aminobutyrique, un neurotransmetteur inhibant l’activité neuronale. Une tomate enrichie en GABA aurait donc, selon le fabricant, des effets bénéfiques sur le sommeil. serait, selon un rapport de l’Agence sanitaire française, presque impossible à obtenir de manière conventionnelle en raison de la position des mutations opérées dans la séquence d’ADN. D’autres modifications sont, quant à elles, tout bonnement impossibles à obtenir conventionnellement, comme dans le cas de plantes exprimant des pesticides ARNLes NTG pourraient permettre de modifier des séquences de gènes produisant des microARN (miARN) chez une plante afin de réduire l’expression d’un gène de la plante ou dans le but de réduire l’expression de gènes vitaux chez les insectes ravageurs qui la consomment – et potentiellement chez des organismes non-cibles comme les pollinisateurs. Ce type de mutations, décrit par des chercheurs de l’Office fédéral de protection de la nature (Allemagne), est irréalisable en sélection conventionnelle.
Bohle F, Schneider R, Mundorf J, Zühl L, Simon S and Engelhard M (2024) Where does the EU-path on new genomic techniques lead us?. Front. Genome Ed. 6:1377117. doi: 10.3389/fgeed.2024.1377117.
Deux catégories de plantes NTG ? Le trompe-l’œil de la Commission européenne
Dans sa proposition de règlement, la Commission européenne propose de différencier deux catégories de plantes issues des NTG :
- La première, NTG1, correspond aux végétaux qui « pourraient également être obtenus naturellement ou par obtention conventionnelle », et qui seraient à ce titre exonérés de toute obligation d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage ;
- La seconde catégorie, NTG2, rassemble les plantes ne respectant pas cette condition, et dont la commercialisation demanderait une évaluation des risques allégée par rapport aux OGM de première génération ainsi que des garanties de traçabilité.
Cette différenciation suppose de définir les végétaux qui pourraient émerger naturellement ou par le biais de la sélection conventionnelle. Les critères de la Commission européenne pour ce faire s’avèrent plus que permissifs : 94 % des plantes NTG en cours de développement seraient considérées comme des NTG1 (voir point 4 ci-dessous).
4. La fausse équivalence entre plantes NTG et conventionnelles
Le projet de règlement européen repose sur le concept d’équivalence entre plantes NTG et issues de la sélection conventionnelle. Mais la Commission européenne a retenu des critères d’équivalence inadaptés, selon de nombreux scientifiques dont le biologiste Yves Bertheau, artisan des méthodes de détection des OGM transgéniques. « Il n’y a aucune base biologique aux chiffres de la Commission », déclarait-il en janvier 2024, lors d’un colloque organisé par POLLINIS et le député Stéphane Delautrette (PS) à l’Assemblée nationale.
L’avis publié un mois plus tôt par l’Agence sanitaire française (Anses) concluait aussi à l’absence « de fondement scientifique » aux critères proposés par la Commission pour considérer un végétal NTG équivalent à une plante produite conventionnellement. Il est donc impossible de comparer l’édition génomique des plantes et la sélection conventionnelle sur la base des seuls critères moléculaires retenus par le texte de loi.
Ces derniers ouvrent pourtant la voie à une grande liberté de manipulation du génome, autorisant des modifications qui peuvent notamment inclure l’équivalent de plus de 400 mutations ponctuelles et des délétions de taille illimitée« Des manipulations scientifiques comme future loi sur les OGM/NTG ? », Eric Meunier (Inf’OGM), 2023. L’avis de l’Anses critique à cet égard l’absence de corrélation entre les critères moléculaires (nombre, taille et type de modifications) et le risque associé aux modifications génétiques apportées. « Le document technique indique que des catégories de plantes qui seraient équivalentes en type, taille et nombre de variations ou modifications génétiques seraient équivalentes en type de caractères et niveau de risques. Ce postulat n’a pas de justification scientifique », tranchent ainsi les experts de l’AgenceAvis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’analyse scientifique de l’annexe I de la proposition de règlement de la Commission européenne du 5 juillet 2023..
La version du texte adoptée sept mois plus tard par le Parlement européen n’a pas corrigé les failles du projet initial. Au contraire, les eurodéputés ont fixé le seuil maximal de modifications à 3 par séquence codanteLa séquence codante d’un gène est la partie de l’ADN ou de l’ARN qui sera traduite en protéine. . Or, ces dernières se comptent par milliers dans le génome de la plupart des végétaux. Le blé, et ses plus de 110 000 séquences codantes, pourrait ainsi faire l’objet de 330 000 mutations sans obligation d’évaluation des risques.
En redéfinissant les critères d’équivalence pour revoir le seuil de modifications, la nouvelle version du Parlement crée en réalité une illusion de rigueur, suggérant à tort qu’elle est plus protectrice que le projet de l’exécutif. La responsable du plaidoyer en matière d’innovation végétale pour Euroseeds, une association représentant l’industrie des semences en Europe et composée notamment de BASF, Bayer, Corteva et Syngenta, conseillait ainsi récemment « aux entreprises d’examiner la proposition de la Commission. (…) Les amendements aux critères que nous avons vus de la part du Parlement s’ouvrent un peu, donc, si vous restez dans le cadre de la proposition de la Commission, vous serez probablement aussi dans le cadre de ce que le Parlement actuel a adopté »« Trading with Europe: Q&A with Petra Jorasch », Seedworld (2024).
5. Les plantes NTG ne résoudront pas la crise climatique
Dans son avis de mars 2024, l’Agence sanitaire française (Anses) rappelait que les végétaux NTG ne peuvent pas résoudre les causes profondes du changement climatiqueLa publication du rapport, finalisé en janvier 2024, a été bloquée sur « pression politique », explique Le Monde.« Risques et enjeux socio-économiques liés aux plantes NTG », Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective. Les nouveaux OGM ne sont, au mieux, que des pansements, et ne représentent en aucun cas une réponse pérenne à l’actuelle crise climatique.
De plus, la capacité des NTG à produire des végétaux résistants au manque d’eau ou à des hausses de température reste à prouver. De telles plantes sont en effet les plus complexes à produire puisque les fonctions de résistance au stress hydrique impliquent différents gènes.
Et malgré ses déclarations« Les nouvelles techniques génomiques peuvent grandement contribuer à des systèmes agro-alimentaires durables », écrit CropLife Europe, qui représente les firmes de l’agrochimie à Bruxelles, dans sa note de positionnement dédiée aux NTG., l’industrie semble d’ailleurs éloignée de ces préoccupations dans les faits. Après avoir étudié 148 plantes NTG en cours de développement, des chercheurs de l’Office fédéral de protection de la nature (Allemagne) ont montré que seule une poignée de ces végétaux (environ 5 %) visaient une résistance accrue au stress abiotique, dont la tolérance aux sécheresses fait partie, la majorité étant développée pour répondre à des préoccupations commerciales et industriellesBohle F, Schneider R, Mundorf J, Zühl L, Simon S and Engelhard M (2024) Where does the EU-path on new genomic techniques lead us?. Front. Genome Ed. 6:1377117. doi: 10.3389/fgeed.2024.1377117.
Une situation qui n’est pas sans rappeler les engagements non tenus des premières génération d’OGM en matière de durabilitéTwenty years of failure, Greenpeace, 2015. Alors qu’elles devaient permettre une réduction de l’usage des pesticides, elles ont contribué à leur utilisation accrue, à renforcer les profits du secteur de l’agrochimie et sa mainmise sur les systèmes agricoles.
La résilience et la durabilité des cultures – notamment face à la crise climatique – dépendent en réalité des composantes des écosystèmes et de leurs interactions : pratiques mises en œuvre sur l’exploitation, conditions climatiques locales, qualité du sol, ressources en eau, présence et diversité des pollinisateurs… Autrement dit, la durabilité consiste en une relation mutuelle entre l’ensemble de ces facteurs : ce ne sont pas les variétés qui sont ou non durables, mais bien les couples entre les variétés et les systèmes agraires.
6. NTG et réduction des pesticides : économie de la promesse brisée
Les OGM de première génération sont pour la plupart des variétés tolérantes aux herbicides, qui concentrent 89 % des surfaces d’OGM cultivées dans le monde en 2019. Or, des études sur le sujet ont démontré l’augmentation de l’utilisation des herbicides liée au développement des cultures de plantes OGMM. Beckert, Y. Dessaux, C. Charlier, H. Darmency, C. Richard, I. Savini, A. Tibi (éditeurs), 2011. Les variétés végétales tolérantes aux herbicides. Effets agronomiques, environnementaux, socio-économiques. Expertise scientifique collective, synthèse du rapport, CNRS-INRA (France), 84 p..
Dans le cas plus minoritaire des plantes OGM produisant des molécules insecticides, les ravageurs ciblés y ont développé à terme une résistance, annulant ainsi l’efficacité de la modification génétique et rendant finalement obligatoire le recours aux pesticidesAtlas des Pesticides 2023, Heinrich-Böll-Stiftung Paris & La Fabrique écologique.
Quant à la nouvelle génération d’OGM, moins d’un végétal NTG sur cinq en cours de développement dans le monde vise à réduire l’utilisation de pesticidesBohle F, Schneider R, Mundorf J, Zühl L, Simon S and Engelhard M (2024) Where does the EU-path on new genomic techniques lead us?. Front. Genome Ed. 6:1377117. doi: 10.3389/fgeed.2024.1377117, et l’échec des premières générations d’OGM en la matière laisse dubitatif quant à leur capacité à remplir cet objectif.
Or, plusieurs travaux démontrent la possibilité d’adopter une agriculture sans pesticides en Europe d’ici 2050Par exemple, ce rapport de l’IDDRI. Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine, X. Poux et P-M. Aubert, 2018, sans avoir recours aux nouveaux OGM, en soutenant pour ce faire les principes de l’agroécologie. Cela implique la pratique des techniques agricoles respectueuses et restauratrices du vivant, sans intrants chimiques ou génétiques, et intégrées dans un système de transformation et de distribution locales.
Par ailleurs, des alternatives aux pesticides de synthèse existent et sont déjà adoptées quotidiennement par de nombreux agriculteurs qui se passent d’OGM. Ces systèmes agricoles innovants sont à encourager pour permettre et faciliter la transition agroécologique dont les insectes pollinisateurs ont besoin.
Lexique
- ADN : Acide désoxyribonucléique. Support des informations génétiques d’un organisme, constitué de deux brins enroulés en double hélice et formés chacun d’une succession de nucléotides.
- ARN : Acide ribonucléique. Copie d’un des deux segments d’ADN qui est synthétisé lors de la transcription et notamment utilisé par les cellules pour permettre la création de protéines.
- CRISPR-Cas : dans son rapport de janvier 2024, l’Anses définit CRISPR-Cas comme un complexe (formé d’une enzyme capable de couper l’ADN et d’un brin d’ARN guide) « utilisé pour créer une cassure double brin de l’ADN à un site spécifique, et activer en conséquence les mécanismes intracellulaires de réparation de l’ADN ». De ces mécanismes peuvent naître des modifications du génome (délétion, insertion…), ces dernières pouvant être guidées par la main humaine via des matrices de réparation.
- NTG : nouvelles techniques génomiques. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les définit comme « des techniques de reproduction moléculaire utilisées pour modifier le matériel génétique d’un organisme développées depuis l’adoption de la législation européenne sur les OGM en 2001 »« Nouvelles techniques génomiques », EFSA.
- Cisgénèse : modification du matériel génétique d’un organisme avec introduction d’une séquence d’ADN provenant de la même espèce.
- Mutagénèse dirigée : production de mutations au niveau de sites choisis par le sélectionneur.
- Transgénèse : introduction, dans le patrimoine génétique d’un organisme vivant, d’une séquence d’ADN provenant d’une autre espèce. C’est la méthode appliquée pour les OGM de première génération« Transgénèse », Actu Environnement.
- Sélection conventionnelle : croisement, sur plusieurs générations, de variétés de plantes possédant des caractéristiques souhaitables (résistance à un virus, adaptation aux conditions climatiques locales…).
- Séquence codante : partie de l’ADN ou de l’ARN d’un gène qui sera traduite en protéine.