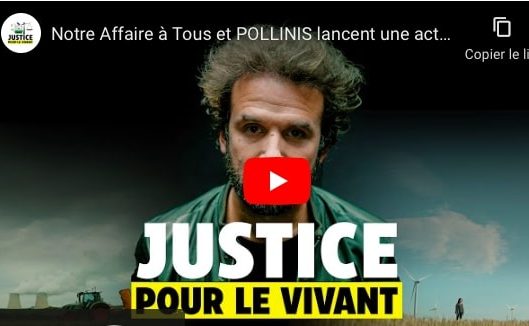DEMANDER JUSTICE POUR LE VIVANT
Depuis plus de quarante ans, l’État français n’a eu de cesse de déclarer sa volonté de préserver les espèces et les espaces de son territoire. Cette volonté affichée d’enrayer le déclin de la biodiversité s’est traduite par la signature de nombreux traités et accords européens et internationaux, ainsi que l’établissement de stratégies et plans nationaux. Une démarche consacrée par la Charte de l’environnement. Pourtant, les stratégies de protection de la biodiversité mises en œuvre ne sont ni à la hauteur des ambitions, ni de l’urgence. Et l’érosion du vivant sur le territoire français s’accélère avec des conséquences potentiellement catastrophiques sur les équilibres des écosystèmes et l’avenir des générations futures.
Les évaluations françaises de l’état de la biodiversité ont régulièrement mis en évidence un déclin généralisé. En Europe, la masse des insectes ailés a déjà diminué de 75 % en moins de trente ans, un chiffre extrapolable à la France, selon les chercheurs1. Un tiers des oiseaux communs a disparu en moins de 15 ans, selon le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Les résultats de 2019 du programme de sciences participatives Suivi temporel des oiseaux communs (STOC), qui produit des indicateurs annuels sur l’abondance des espèces dans différents habitats (forêt, ville, campagne etc.) ont montré que la chute la plus importante concerne les oiseaux spécialistes des milieux agricoles (-29,5 %). Les scientifiques du programme pointent « l’intensification des pratiques agricoles ces dernières décennies, plus particulièrement depuis 2008-2009. Une période qui correspond entre autres à la généralisation des néonicotinoïdes, insecticides neurotoxiques très persistants, à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune (…). »
L’effondrement des populations touche aussi les reptiles, les batraciens, la faune du sol comme les vers de terre. Ces résultats alarmants sont symptomatiques de l’état général de la biodiversité en France. Surtout, ils sont révélateurs de la dégradation des habitats (sols, eau, air) sous la pression des activités agricoles intensives et de l’usage massif de pesticides de synthèse2
Le déclin de la biodiversité résulte d’une ignorance volontaire de ses causes. Le consensus scientifique, alimenté par un nombre croissant de publications, établit le lien entre le déclin de la biodiversité et le développement de l’agriculture intensive, ainsi que son usage immodéré et systématique des pesticides3. La société civile alerte sur cette causalité depuis des décennies. Or, les pouvoirs publics refusent d’agir. Aucune des mesures prises par la France n’est à la hauteur de la catastrophe écologique en cours.
Depuis 15 ans, les plans nationaux successifs visant à réduire de 50 % l’usage des pesticides à l’horizon 2018 ( (Écophyto I) puis 2025 (Ecophyto II et II+) ont échoué à endiguer le recours massif aux produits de synthèse. En 2020, les ventes de pesticides ont augmenté de 23 %, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture. La France a même choisi en 2020 de réautoriser temporairement les néonicotinoïdes pour l’enrobage des semences de betterave sucrière, des pesticides interdits à cause de leur extrême toxicité même à des doses infimes.
Plus grave, à cause d’un processus d’homologation défaillant, des centaines de produits nocifs pour le vivant sont autorisés sans contrôle rigoureux et sans évaluation pertinente de leurs effets réels sur la biodiversité. Répandus sur les cultures de façon systématique, les produits phytosanitaires sont transportés par voie atmosphérique, fixés dans les sols, entraînés par les eaux par lixiviation et ruissellement, et s’infiltrent dans les eaux souterraines, de sorte que les pollutions présentent un caractère permanent et diffus, y compris dans les zones non traitées.
Surtout, ces produits ont des répercussions négatives sur des espèces non visées. On retrouve par exemple dans l’eau des substances actives de pesticides qui présentent une toxicité pour les organismes aquatiques, théoriquement hors de leur cible d’action.
La responsabilité de l’État est d’établir des lois, des procédures et des processus d’autorisation des produits ayant pour objectif la préservation du vivant. Les insuffisances à ce devoir de protection sont constitutives de graves manquements de l’État français, de nature à engager sa responsabilité. POLLINIS et l’association de juristes Notre Affaire à Tous ont donc décidé de lancer une action en justice contre l’État afin de l’obliger à respecter ses engagements et ses obligations en matière de protection de la biodiversité.
Cette action en justice, qui pointe la manière dont l’État omet de protéger la nature à travers ses lois et règlements, est la toute première action de ce type en France et dans le monde. Elle exige le respect des droits de la nature et des droits humains, notamment à la santé et à un environnement sain.
En 2022, l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), l’Association nationale pour la protection des eaux & rivières (ANPER-TOS) et Biodiversité sous nos pieds se sont associées à ce recours contre l’État français. Les cinq ONG ont déposé au Tribunal administratif de Paris le 17 février leur mémoire complémentaire, auquel l’Etat a répondu par un mémoire en défense, le 19 décembre. Un mémoire en réplique a été déposé par les associations le 19 janvier 2023.
Les arguments juridiques et scientifiques mobilisés par les ONG démontrent point par point les manquements de l’État à ses obligations de protection de la biodiversité et sa responsabilité dans la sixième extinction de masse. Leurs mémoires listent également les mesures enjointes à l’État pour mettre un terme à l’ensemble des carences responsables de la défaillance des procédures d’homologation et de mise sur le marché des pesticides.
L’État, dans sa défense, tente d’échapper à sa responsabilité en se cachant derrière le droit européen, qui l’empêcherait d’agir. Ce que les associations dénoncent dans leur mémoire en réplique, qui donne des preuves que l’État français peut bel et bien aller au-delà du cadre défini par l’Union européenne.
Le 10 février 2023, alors que l’instruction allait être clôturée, Phyteis, qui représente les principales entreprises agrochimiques en France (Bayer, Syngenta/ChemChina, BASF…), a déposé un mémoire et demandé à intervenir dans le procès, en soutien à l’État. Les associations ont répondu aux arguments du lobby et de l’Etat dans un mémoire déposé en mars. Tout au long de l’instruction, Phyteis aura usé d’outils de la stratégie du doute, niant la centralité des pesticides dans l’effondrement de la biodiversité et amoindrissant l’ampleur de leur usage sur le territoire français.
Le 1er juin s’est tenue l’audience au tribunal administratif de Paris, au cours de laquelle la rapporteure publique a partagé ses conclusions soutenant de nombreuses demandes des ONG, et réclamant une condamnation de l’Etat pour l’obliger à revoir l’évaluation des risques des pesticides avant leur mise sur le marché et à respecter ses objectifs de réductions de l’usage des pesticides, prévus dans le cadre des plans Ecophyto et dans la réglementation de protection des eaux. Le gouvernement, absent de son propre procès, a été quant à lui été défendu par l’avocat de Phyteis.
Environ un mois après, le 29 juin 2023, le Tribunal a rendu une décision historique. Pour la première fois, un État a été condamné pour sa faute dans l’effondrement de la biodiversité. La justice a ainsi reconnu les failles des procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, le préjudice écologique lié, et la responsabilité de l’État dans cette situation. Elle a également condamné l’État à tout mettre en œuvre pour respecter les objectifs de réduction de l’usage des pesticides, déterminés dans les plans Ecophyto et par la réglementation de protection des eaux. Le tribunal n’a toutefois pas ordonné pas à l’État de revoir les méthodologies d’évaluation des risques – contrairement à ce que préconisait la rapporteure publique.
Le 29 août, le gouvernement a fait appel de la décision, s’enfermant dans son inaction. Il refuse de prendre ses responsabilités et de lutter activement contre l’effondrement de la biodiversité. Les associations, dans cette nouvelle étape, chercheront à obtenir une condamnation ferme de l’État sur la question des méthodes d’évaluation des risques des pesticides. Elles ont en ce sens déposé leurs arguments en novembre 2023.
Le 3 mai 2024, Phyteis a réitéré sa demande d’intervention, en déposant un mémoire dans chacune des procédures d’appel. Comme en première instance, le lobby de l’agrochimie y a fait usage d’une certaine stratégie du doute, tentant de minimiser l’impact des pesticides sur la biodiversité.
La révision de l’évaluation des risques des pesticides avant leur mise sur le marché est un préalable indispensable à la sauvegarde du Vivant. En se fondant sur les derniers développements de la recherche en écotoxicologie, cette révision devra permettre de ne plus ignorer délibérément les connaissances scientifiques disponibles, et d’autoriser ou d’interdire les pesticides en pleine connaissance de leurs effets réels sur les écosystèmes et l’environnement.