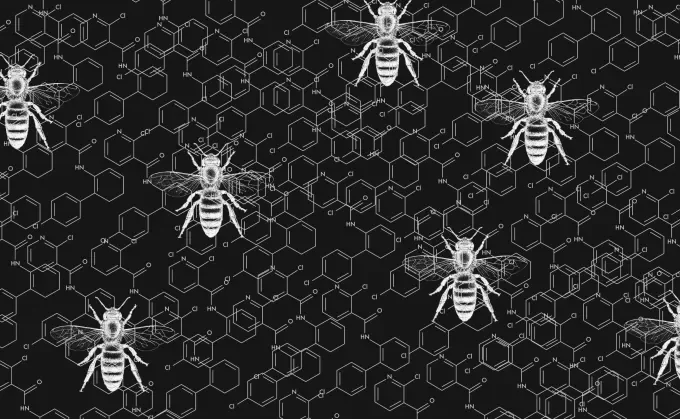SDHI : Une bombe à retardement
Produits phares de l’agrochimie, les fongicides SDHI sont déversés depuis les années 2000 en quantité industrielle en Europe pour tuer champignons et moisissures dans les cultures. Tomates, céréales, pommes, raisins… quasiment tous les produits alimentaires sont contaminés.
En France par exemple, 70 % des cultures de blé tendre et 80 % des cultures d’orge sont traitées avec des SDHI. Ce sont les résidus de pesticides les plus souvent quantifiés dans nos aliments1. Ces molécules agissent sur les mitochondries des cellules en inhibant une enzyme, la succinate déshydrogénase (SDH), ce qui bloque la respiration cellulaire et provoque la mort de la cellule.
Ces fongicides ont passé les tests d’évaluation règlementaire avant leur mise sur le marché – tests censés garantir que ces produits ne poseront pas de risques majeurs – mais des expériences en laboratoire menées en 2017 par Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS/INSERM, et Paule Bénit, ingénieure de recherche à l’INSERM, révèlent que les molécules SDHI n’agissent pas uniquement sur les champignons, mais peuvent bloquer également la respiration des cellules humaines et des vers de terre.
L’enzyme SDH sur laquelle agissent les SDHI est, de fait, présente dans les cellules de quasiment tous les êtres vivants, des bactéries jusqu’aux mammifères. Chez l’Homme, les perturbations de l’enzyme SDH peuvent provoquer des maladies neurodégénératives, des cardiopathies, des tumeurs… Spécialistes des maladies mitochondriales, et craignant une catastrophe sanitaire et environnementale, Pierre Rustin et Paule Bénit ont alerté l’autorité sanitaire française (ANSES) en octobre 2017. Quelques mois plus tard, devant l’inertie de l’agence, ils ont signé avec huit scientifiques (cancérologues, médecins et toxicologues du CNRS, de l’INSERM et de l’INRA) une tribune dans la presse2 demandant le retrait immédiat de ces pesticides.
À la suite de cette publication, l’ANSES a finalement missionné un comité d’experts pour se pencher sur le dossier, qui a rendu son avis3 en janvier 2019, concluant à l’absence d’éléments pour enclencher l’alerte sanitaire, alors même qu’il subsistait « un fort degré d’incertitude sur nombre de questions ».
Cet avis comportait cependant plusieurs limites. Selon Pierre Rustin et Paule Bénit, le mécanisme d’action très particulier des SDHI sur les cellules n’a pas été pris en compte par les experts missionnés par l’agence, dont aucun n’est spécialiste des maladies mitochondriales.
En 2020, alors que la pression de la société civile et de la communauté scientifique grandit, l’ANSES lance un groupe de travail dédié au SDHI, censé apporter en trois ans des réponses plus précises que celles du GECU. Il rend son avis en décembre 2023.
Une étude4 de Paule Bénit et Pierre Rustin datant de novembre 2019 réaffirme que les tests en vigueur sont aveugles sur la toxicité des SDHI et met en évidence in vitro que « huit molécules fongicides SDHI (…) ne se contentent pas d’inhiber l’activité de la SDH des champignons, mais sont aussi capables de bloquer celle du ver de terre, de l’abeille et de cellules humaines, dans des proportions variables ». L’équipe a également démontré que « les conditions des tests réglementaires actuels de toxicité masquent un effet très important des SDHI sur des cellules humaines : les fongicides induisent un stress oxydatif dans ces cellules, menant à leur mort ».
Par ailleurs, les études démontrant la toxicité de molécules SDHI sur des espèces non cibles s’accumulent. Il a été prouvé que le boscalid inhibe par exemple la croissance du poisson-zèbre à de faibles doses5 retrouvées dans l’environnement. Ce SDHI très utilisé est aussi toxique aux doses les plus faibles pour les abeilles qui sont exposées sur la durée à cette molécule très persistante, avec un impact documenté sur la durée de vie des ouvrières et la taille des colonies6.
Deux autres SDHI, l’isopyrazam et le bixafen, entrainent des effets létaux et des malformations sur des embryons d’amphibiens7. Très largement utilisé par les agriculteurs européens, le bixafen altère à lui seul le développement du cerveau et de la moelle épinière des poissons-zèbres et provoque des dommages de l’ADN dans les cellules humaines8. En avril 2023, la revue Environmental Pollution publiait une étude inédite s’intéressant aux effets de l’exposition des reines d’abeilles mellifères (Apis mellifera) à un autre fongicide SDHI, le boscalid. Les résultats de ces travaux renforcent « le besoin d’inclure la reproduction (…) dans les procédures d’évaluation du risque des pesticides ».
L’avis rendu en décembre 2023 par le groupe de travail SDHI de l’ANSES souligne lui-même plusieurs points inquiétants, comme des effets importants sur de multiples organes et des lacunes dans les dossiers réglementaires. Il omet par ailleurs complétement la question de l’impact de ces fongicides sur la biodiversité. Ses recommandations soulignent la nécessité de mettre en place cette évaluation : « Le groupe de travail recommande la mise en place d’une expertise collective consacrée spécifiquement aux effets des SDHI et à l’évaluation des risques pour la biodiversité et la santé des écosystèmes ». Il suggère également de mettre en place une évaluation spécifique de la mitotoxicité.
Alors qu’il est désormais prouvé scientifiquement que les SDHI peuvent agir sans discrimination sur la respiration cellulaire de nombreux organismes, POLLINIS exhorte les autorités publiques à prendre des mesures d’urgence. Avec les chercheurs qui ont lancé l’alerte, POLLINIS a déposé une pétition au Parlement européen (une démarche administrative particulière, différente des pétitions de mobilisation citoyenne) demandant un moratoire sur les SDHI et une réévaluation de ces molécules.
Après son examen en septembre 2020, la commission des pétitions a souhaité conserver ce dossier à l’agenda européen en gardant la pétition ouverte et en demandant sa transmission à l’autorité sanitaire européenne (EFSA) ainsi qu’aux États membres. POLLINIS espère ainsi susciter un débat plus large au sein du Parlement européen sur les failles du système d’homologation des pesticides.
Au niveau français, l’association a également mené une campagne d’interpellation des ministres de l’Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique. Environ 67 000 personnes leur ont déjà demandé le retrait immédiat des fongicides SDHI du marché.
POLLINIS demande une mise à jour scientifique des protocoles européens d’évaluation, sur la base de l’état actuel des connaissances, pour évaluer la toxicité réelle des pesticides, comme prévu par le cadre réglementaire (règlement (CE) n°1107/2009, article 4). La pétition de POLLINIS et des deux scientifiques a été examinée à nouveau le 15 mars 2022 par la commission des pétitions. Elle a reçu le soutien des eurodéputés de cette instance, qui ont décidé de la maintenir ouverte, en attendant les prochaines évaluations de l’EFSA sur les SDHI, et de demander des informations complémentaires et actualisées sur ces molécules à la Commission européenne.
Le 16 février 2023, POLLINIS a déposé un recours au Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la Commission de renouveler, pour la 5ème fois et en dépit des alertes scientifiques sur les dangers des pesticides SDHI, l’extension d’approbation du boscalid dans l’Union européenne. En attente du jugement depuis un an, POLLINIS a de nouveau déposé, le 9 février 2024, un recours contre la 6ème prolongation de l’autorisation du boscalid.
Il est indispensable d’appliquer le principe de précaution en retirant du marché, non seulement le boscalid, mais également tous les autres SDHI.