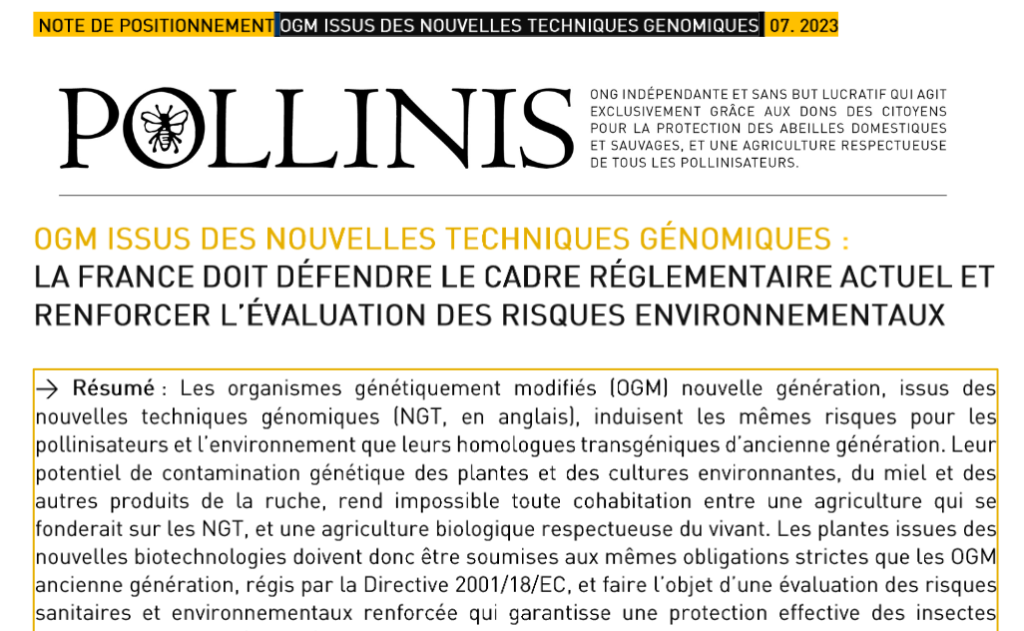NOUVEAUX OGM : MENACES IMMINENTES SUR LA BIODIVERSITÉ
Trente ans après l’émergence des premiers organismes génétiquement modifiés (OGM) en agriculture, les firmes de l’agrochimie développent à présent des plantes et des semences modifiées par le biais des nouvelles techniques génomiques (NGT, en anglais) dont, notamment, les « ciseaux moléculaires » Crispr-Cas9. Contrairement aux OGM traditionnels qui dépendaient principalement de la transgénèse (introduction d’un gène d’une autre espèce), ces nouveaux procédés permettent d’éditer directement le génome d’un organisme.
Si l’Europe s’est longtemps tenue à l’écart des cultures génétiquement modifiées, ces « nouveaux OGM » pourraient prochainement conquérir les champs du continent. La Commission européenne a en effet élaboré, dès 2020, un plan de dérégulation des organismes issus des NGT. Aboutissement de ce travail : sa proposition de réglementation, présentée le 5 juillet 2023, qui exonère la grande majorité de ces nouvelles plantes génétiquement modifiées de toute obligation d’évaluation des risques, d’étiquetage et de traçabilité.
Dans sa proposition de règlement, la Commission européenne distingue deux catégories de plantes NGT. Dans la catégorie 1 se trouvent les plantes qui, selon elle, auraient pu être créées « au moyen de techniques d’obtention conventionnelles », à savoir la sélection végétale. Elle utilise à cet effet un seuil de modifications génétiques particulières, en dessous duquel les plantes génétiquement modifiées appartiennent à la première catégorie, et au-delà duquel se situent les plantes de catégorie 2.
Les plantes NGT de catégorie 1, considérées par l’exécutif européen comme équivalentes aux plantes conventionnelles, représentent 94%1 des nouveaux OGM, et leur mise sur le marché ne nécessiterait qu’une procédure de notification – sans évaluation des risques préalable, ni mesure de traçabilité ou d’étiquetage. Des obligations auparavant prévues dans la directive européenne 2001/18 qui encadre encore la culture des OGM sur le continent et permet aux Etats-membres de les interdire sur leur sol.
La proposition de la Commission, si elle venait à être adoptée, permettrait la mise sur le marché d’un grand nombre de plantes génétiquement modifiées sans évaluation des risques, ni traçabilité ou étiquetage. Présentées comme des solutions miracles face au changement climatique, les plantes issues de NGT ne semblent pourtant pas au rendez-vous de leurs promesses et soulèvent plusieurs inquiétudes.
Une récente étude de l’Agence fédérale allemande de conservation de la nature1 évoque ainsi différents impacts potentiels de ces plantes sur les écosystèmes. Elle indique par exemple que développer des plantes résistantes à différents facteurs de stress (maladies, ravageurs, sécheresse…) pourrait également les rendre invasives, ou qu’améliorer certains traits esthétiques des fruits ou légumes, comme en empêcher le brunissement, pourrait en contrepartie affaiblir leur résistance à des pathogènes. Dans ce dernier cas, cela pourrait entraîner indirectement l’augmentation de la quantité de pesticides à utiliser pour pallier ces faiblesses. Le projet de la Commission ne cherche pas, à cet égard, à combler le manque de connaissances sur les risques environnementaux des nouveaux OGM.
Plus problématique encore, les modifications génétiques opérées avec les NGT ne peuvent pas être circonscrites : les organismes sexuellement compatibles d’un même écosystème peuvent en effet se transmettre certains gènes. Permis par exemple via la pollinisation, ce phénomène de transfert de gènes pourrait contaminer génétiquement des végétaux sur plusieurs kilomètres autour de la culture, comprenant à la fois les champs voisins, qu’ils soient en agriculture conventionnelle ou biologique, ainsi que certaines plantes sauvages. La dérégulation des nouveaux OGM menace ainsi directement les alternatives au modèle agricole dominant, quand bien même elles représentent les pistes les plus prometteuses pour enrayer l’extinction des pollinisateurs et de la biodiversité.
A cette menace s’ajoute une faille démocratique : ce risque de contamination, couplé à l’absence quasi-totale de traçabilité et d’étiquetage, mépriserait le droit à l’information – pourtant inscrit dans les traités européens – et s’opposerait à la volonté de la majeure partie de la population d’être dûment informée de la présence d’OGM dans leurs aliments. Dans un récent sondage mené par Kantar pour Greenpeace, 92 % des français interrogés ont déclaré souhaiter un étiquetage des produits alimentaires contenant des nouveaux OGM3 .
La proposition de la Commission n’intègre à cet égard aucune clause de sauvegarde. Autrement dit, les États-membres ne pourront pas choisir d’exclure les nouveaux OGM de leur territoire national, comme c’est actuellement le cas pour la France concernant la première génération d’OGM.
Derrière cette proposition semble en réalité s’immiscer l’influence des lobbys de l’agrochimie, dont les organisations interfilières ont félicité la Commission européenne pour ses travaux. Les CRISPR-files4, fichiers révélés par l’ONG Corporate Europe Observatory, témoignent ainsi des efforts menés par l’industrie pour influer sur la première étude d’impact menée par la Commission au sujet des NGT, en 2021. Plusieurs organisations, dont POLLINIS, ont également alerté des biais en faveur de la dérégulation des nouveaux OGM dans les consultations publiques menées par l’exécutif.
Argument phare de la Commission et de l’industrie pour justifier la dérégulation des nouveaux OGM : la prétendue équivalence entre les plantes NGT de catégorie 1 et les plantes obtenues par sélection végétale conventionnelle. Les critères d’équivalence tels qu’ils sont définis laissent en réalité une immense liberté dans la manipulation du génome, comme par exemple des délétions de taille illimitée.
Ces critères ont d’ailleurs été décriés par l’ANSES dans une note d’analyse publiée le 22 décembre 2023 qui pointe l’absence criante de clarté et de pertinence scientifique des « critères d’équivalence » utilisés. Dans ce même document, le comité technique met également en cause la stratégie générale utilisée par la commission européenne et qui consiste à se baser uniquement sur les aspects moléculaires sans prendre en compte les caractères des plantes et leurs éventuels risques.
Face aux risques que ces nouveaux OGM font peser sur les écosystèmes, et afin d’éviter une contamination génétique qui signerait la fin de l’agriculture sans OGM (dont la filière biologique) en Europe, POLLINIS appelle au rejet de la proposition de règlement de la Commission. En 2020, l’association a lancé à cet effet une vaste campagne de mobilisation aux côtés de 26 organisations européennes partenaires, dont l’antenne européenne des Amis de la Terre, Corporate Europe Observatory ou encore Slow Food Europe.
En février 2023, POLLINIS s’est ainsi rendue à Matignon pour remettre, aux côtés de la Confédération paysanne, d’Agir pour l’Environnement et du collectif « Objectif Zéro OGM », une pétition – rassemblant aujourd’hui plus de 500 000 signataires – aux représentants de la Première ministre Elisabeth Borne. Quelques jours plus tard, l’association se rendait à Bruxelles pour la remettre également à des représentants de la Commission européenne.
Les associations ont aussi alerté, aux côtés de 40 000 citoyens français, le ministre de la Transition Écologique Christophe Béchu pour lui demander de s’impliquer dans le processus législatif et de s’assurer que les enjeux environnementaux y soient réellement pris en compte.
Depuis la publication du projet de la Commission européenne, et alors que le calendrier des négociations européennes s’est accéléré, l’ONG et ses partenaires continuent à alerter et à demander à la France de se positionner contre le projet européen de dérégulation, notamment à travers une tribune et des courriers adressés au ministre de l’Agriculture, à la Première ministre ainsi qu’au président de la République.
Les associations ont ainsi obtenu un nouveau rendez-vous à Matignon le 6 décembre 2023 au cours duquel POLLINIS a exigé le rejet du texte par la France pour éviter l’arrivée massive des nouveaux OGM dans les champs européens.
Le 6 février 2024, à veille du vote par le Parlement européen du projet de dérégulation des nouveaux OGM, POLLINIS et plusieurs organisations – dont la Confédération Paysanne et Greenpeace – se sont rassemblées devant l’hémicycle de Strasbourg pour alerter les eurodéputés sur les dangers de cette réglementation. Malgré la mobilisation, les Parlementaires ont voté en faveur de la mise sur le marché des nouveaux OGM sans évaluation des risques.
Plus tard dans le mois, et malgré les milliers d’interpellation menées par les sympathisants de POLLINIS, les députés français de la Commission des affaires européennes rejetaient la proposition de résolution européenne (PPRE) visant à positionner l’Assemblée nationale contre la dérégulation des nouveaux OGM.
La pétition compte aujourd’hui plus d’un demi-million de signatures. La France, premier producteur agricole de l’Union européenne, est le pays le plus représenté parmi les signataires, rassemblant plus de 200 000 citoyens opposés à la dissémination incontrôlée des nouveaux OGM. Afin de respecter le principe de précaution, et d’écouter la majorité des citoyens qui s’opposent à ce projet, POLLINIS demande au gouvernement français et aux élus européens de :
- Rejeter la proposition de règlement de la Commission européenne « concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques » ;
- Appliquer strictement le principe de précaution en interdisant la culture de l’ensemble des OGM, dont ceux obtenus via les NGT, tant que leurs risques sur les pollinisateurs, la biodiversité et la santé n’auront pas été exhaustivement évalués par une autorité indépendante ;
- Continuer d’appliquer la clause de sauvegarde nationale en vigueur pour l’ensemble des OGM, permettant à chaque Etat membre de rester souverain sur ces décisions fondamentales sur leur système agricole et alimentaire.