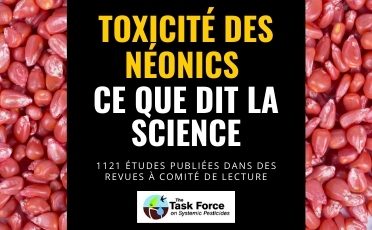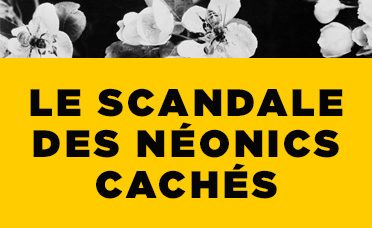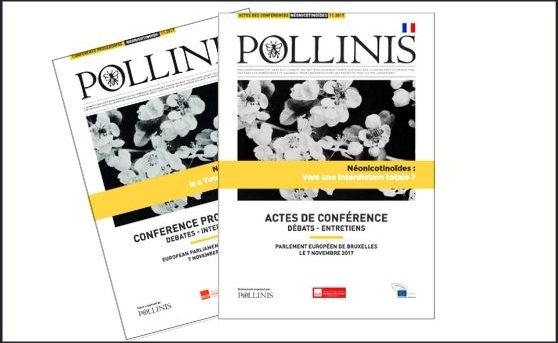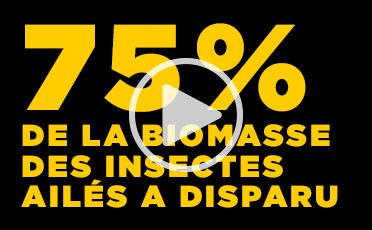Interdire définitivement les néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes sont des insecticides neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central des insectes, provoquant la paralysie et la mort. Conçues dans les années 90 pour lutter contre les ravageurs dans les grandes cultures, ces molécules sont à large spectre – elles tuent en réalité l’ensemble des arthropodes, et de nombreux autres organismes vivants. Elles sont en grande partie responsables de la hausse de mortalité des abeilles, de l’extinction en cours des insectes et, par ricochet dans les chaînes alimentaires, de la disparition des oiseaux communs d’Europe et des poissons de rivière. Composée de sept molécules (imidaclopride, thiaméthoxame, clothianidine, dinotéfurane, acétamipride, nitenpyrame, thiaclopride), la famille des néonicotinoïdes représente à elle seule 40 % du marché mondial des insecticides agricoles, ce qui en fait les insecticides les plus vendus au monde1.
Ils sont ainsi utilisés principalement dans les grandes cultures telles que le blé, l’orge ou le maïs, mais aussi largement dans la culture de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou encore en arboriculture. Les néonicotinoïdes sont vendus essentiellement sous forme de semences enrobées (les graines sont enduites d’insecticide) et sont donc utilisés de manière préventive et systématique : les agriculteurs les utilisent qu’il y ait ou non des insectes dits « nuisibles » dans les champs.
La nocivité des néonicotinoïdes fait l’objet d’un consensus scientifique incontestable. Au cours des 25 dernières années, plus d’un millier d’études – analysées par la Task Force on Systemic Pesticides (TFSP), un consortium de scientifiques indépendants – ont montré qu’ils déciment les abeilles mais aussi tous les insectes, notamment les pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages, bourdons, osmies…), ainsi que les araignées, les milles-pattes, les crustacés, les vers de terre… Ils sont dangereux à des doses d’exposition infimes (toxicité aiguë) mais également indirectement par le biais des puissants effets sublétaux qu’ils engendrent : suppression du système immunitaire, perturbation du sens de l’orientation ou de la capacité de reproduction…2 Comme se sont des insecticides systémiques, la substance active se diffuse par la sève de la plante au fur et à mesure de sa croissance, et se retrouve dans l’ensemble de la plante, notamment les parties prisées des pollinisateurs : le pollen, le nectar et les gouttelettes d’eau présentes le matin à l’extrémité des feuilles des plantes (la guttation).
Dans les faits, entre 1,6 % et 20 % du produit actif est absorbé par la plante, tandis qu’au moins 80 %, est lessivé dans le sol et contamine les cours d’eau et les nappes phréatiques pour plusieurs années 3. Cette dissémination dans l’eau, la terre ou les poussières est incontrôlable. La persistance des néonicotinoïdes – parfois durant plusieurs années dans certains sols – provoque des dégâts à long terme, avec dans certains cas des résidus (métabolites) encore plus dangereux que les molécules elles-mêmes.4
Leur usage entraîne aussi l’affaiblissement des défenses naturelles des cultures et favorise la prolifération et la résistance des insectes ravageurs, sans pour autant améliorer de manière significative les rendements agricoles5. En rendant les agriculteurs toujours plus dépendants des intrants chimiques et en détériorant leurs marges, cette nouvelle génération de pesticides continue de profiter unilatéralement aux grands acteurs de l’industrie agrochimique.
Les protocoles d’évaluation des pesticides, qui ont permis leur mise sur le marché dans les années 90, n’ont pas détecté leur dangerosité. Pour que leurs effets dramatiques soient reconnus, il aura fallu les alertes des apiculteurs, qui ont vu leurs colonies décimées avec la commercialisation massive des néonicotinoïdes, la multiplication d’études scientifiques indépendantes accablantes, et plus de deux décennies de mobilisation citoyenne sans précédent.
Les néonicotinoïdes ont été progressivement interdits en Europe à partir de 2018 et en France à partir de 2013, mais de nombreuses exceptions perdurent et les firmes de l’agrochimie poursuivent leur lobbying intensif en faveur de leur utilisation, parvenant à fragiliser les interdictions partielles décidées à l’échelon français et européen. Des solutions économiques (réorientation des aides à l’agriculture, mise en place d’assurance mutualisée en cas de mauvaise récolte…) et agronomiques existent pourtant, et offrent déjà des alternatives reconnues. Dans un bilan réalisé en 2017 à la demande du ministère de l’Agriculture, l’Anses a identifié des alternatives (chimiques et non chimiques) suffisamment efficaces et opérationnelles pour une majorité des usages. Et dans 78 % des cas analysés par l’agence « au moins une solution alternative non chimique existe ».
Parmi les solutions non-chimiques, de nombreuses possibilités faisant appel aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs sont également disponibles, allant de la diversification et la modification de la rotation des cultures à la modification des dates de semis. Les approches agroécologiques permettant de rétablir la biodiversité (arrêt de la monoculture, restauration du bocage, etc.) permettent une meilleure régulation des ravageurs tels que les pucerons en ramenant leurs ennemis naturels dans leurs environnements (syrphes, coccinelles, chrysope…).
Sur le front réglementaire, l’EFSA (Agence sanitaire européenne) a conclu en 2013 que trois de ces molécules présentaient un risque inacceptable pour les abeilles puis, dans un nouvel avis en 2018, l’EFSA a confirmé que les néonicotinoïdes sont dangereux également pour les pollinisateurs sauvages. La Commission européenne a voté l’interdiction partielle de quatre molécules sur les sept existantes en 2018, mais les molécules de nouvelle génération au mode d’action similaire ne sont pas mentionnées.
De leur côté, certains États membres continuent d’attribuer des dérogations abusives pour contourner les interdictions. Pionnière en Europe, la France a interdit 5 de ces substances en septembre 2018, une interdiction étendue ensuite à des molécules de nouvelle génération, au mode d’action identique, que les firmes agrochimiques commercialisent sous une autre dénomination (sulfoxaflor et flupyradifurone).
Mais sous la pression de la filière betterave-sucre, la France est cependant revenue sur cette interdiction par une modification législative en novembre 2020. La nouvelle loi autorise l’utilisation dérogatoire de semences de betterave traitées aux néonicotinoïdes jusqu’en 2023. Un arrêté a été pris le 5 février 2021, autorisant temporairement leur utilisation pour une durée de cent vingt jours. POLLINIS et six autres organisations ont déposé des recours devant les tribunaux et le Conseil d’État contre cet arrêté, et demandent l’annulation de ce texte.
Suite à un recours déposé devant le Conseil d’État belge par les organisations PAN Europe (Pesticide Action Network), Nature & Progrès Belgique et un apiculteur belge, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt, le 19 janvier 2023, déclarant que les dérogations octroyées en France et en Europe sont illégales. Suite à cette décision, le ministère de l’agriculture déclare qu’il ne mettra pas de dérogation en place en 2023.
Au printemps, le Conseil d’État rend sa décision et confirme l’illégalité des dérogations permettant d’utiliser des semences enrobées de néonicotinoïdes, accordées par le ministère de l’Agriculture aux betteraviers en 2021 et 2022. Cette décision tourne définitivement la page des néonicotinoïdes en France, mais certaines de ces molécules restent autorisées dans d’autres pays européens.